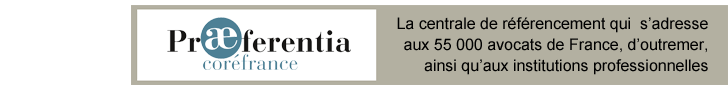Quand un fonds de commerce disparaît au profit d’une somme d’argent plus facile à soustraire aux poursuites, on pourra toujours, et heureusement d’ailleurs, compter sur le droit ! Par une décision du 29 janvier 2025, la Cour de cassation vient rappeler avec force que l’action paulienne n’exige pas la démonstration d’une insolvabilité apparente, dès lors que le préjudice du créancier est réel. Un coup d’arrêt pour les manœuvres dilatoires des débiteurs peu scrupuleux… Décryptage !
Une cession suspecte, un créancier écarté : le point de départ du litige
Tout commence par une rupture de confiance. M. [O], expert-comptable, accompagne la société La Brasserie jusqu’en 2016, avant d’être écarté sans que ses honoraires soient réglés. Il engage alors une procédure en recouvrement, et obtient une condamnation judiciaire en sa faveur en février 2019. Rien d’exceptionnel jusque-là. Sauf que quelques mois avant cette décision, le 15 juin 2018, la société La Brasserie cède précipitamment son fonds de commerce à la société LBR, une structure montée pour l’occasion, et détenue par M. et Mme [N].
A peine la vente conclue, La Brasserie est placée en liquidation judiciaire. Les actifs ont été remplacés par du cash, et le créancier se retrouve face à une coquille vide. Pour M. [O], cette manœuvre ne fait aucun doute : il s’agit d’une fraude. Et le droit lui offre une arme redoutable pour y répondre — l’action paulienne.
L’action paulienne, un outil juridique au service des créanciers lésés
Peu connue du grand public, l’action paulienne n’en est pas moins un mécanisme central de la protection du droit des créanciers. Son principe ? Lorsqu’un débiteur, en connaissance de cause, organise son insolvabilité pour échapper à ses obligations, comme l’explique Daici International spécialiste en cessions d’entreprises, le créancier peut demander au juge de déclarer certains actes inopposables à son égard. Autrement dit, l’acte litigieux — vente, donation ou autre — n’aura pas d’effet à l’égard du créancier, qui pourra poursuivre l’exécution de sa créance comme si l’acte n’avait jamais existé.
Codifiée à l’article 1341-2 du Code civil, cette action repose sur trois conditions cumulatives : l’existence d’un préjudice pour le créancier, l’intention frauduleuse du débiteur, et, lorsque l’acte est conclu à titre onéreux, la complicité du tiers contractant. Dans l’affaire qui nous occupe, la vente du fonds de commerce constitue à la fois un acte à titre onéreux et un transfert d’un actif concret vers une forme de richesse beaucoup plus difficile à localiser.
Une interprétation contestée en appel
En première instance, les juges s’interrogent sur la solidité du fondement invoqué par M. [O]. La cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 6 juillet 2023, rejette son action paulienne, considérant que l’expert-comptable ne rapporte pas la preuve de l’insolvabilité apparente de la société La Brasserie au moment de la cession. Pour les juges, cette démonstration serait incontournable pour faire tomber l’acte litigieux. Mais cette position revient à ériger un obstacle que la loi ne pose pas. Car l’action paulienne n’a jamais été subordonnée à la preuve de l’insolvabilité manifeste. Elle vise précisément à empêcher qu’un débiteur ne devienne insolvable à travers des actes de gestion douteux.
Le préjudice suffit, tranche la Cour de cassation
La chambre commerciale de la Cour de cassation remet les pendules à l’heure dans son arrêt du 29 janvier 2025 (n° 23-20.836). Elle censure fermement la décision de la cour d’appel, affirmant que le succès de l’action paulienne n’est pas conditionné à la preuve de l’appauvrissement du débiteur. Ce qui compte, c’est l’effet de l’acte. Ici, la cession d’un fonds de commerce, bien facilement saisissable, contre une somme d’argent bien plus aisée à dissimuler. Autrement dit, même si le prix de cession est conforme au marché, l’opération devient suspecte dès lors qu’elle fait obstacle aux poursuites du créancier. Le préjudice est clair : un actif identifiable et récupérable a été remplacé par une valeur fuyante. C’est précisément cette logique que la Cour vient consacrer, renforçant ainsi la portée de l’action paulienne comme rempart contre les stratégies de contournement.
Un signal fort envoyé aux débiteurs malveillants
Dans un contexte où les procédures de recouvrement s’enlisent souvent dans les méandres judiciaires, les créanciers sont trop fréquemment confrontés à des débiteurs qui jouent la montre et organisent méthodiquement leur insolvabilité. La substitution d’un bien par des liquidités, l’évasion patrimoniale ou encore les ventes à des sociétés-écrans sont des pratiques aussi répandues que difficiles à combattre. En affranchissant l’action paulienne de la condition d’insolvabilité apparente, la Cour offre un levier plus accessible, car il suffit désormais de démontrer que l’acte litigieux a entravé l’exécution de la créance, sans devoir prouver que le débiteur est complètement démuni.
Une protection renforcée mais encadrée
Pour autant, ce n’est pas un chèque en blanc. En effet, l’action paulienne reste encadrée par des exigences précises, au premier rang desquelles l’obligation de démontrer que le débiteur avait conscience du préjudice causé et que le tiers acquéreur, en cas d’acte à titre onéreux, connaissait ou ne pouvait ignorer cette intention. Mais ces critères sont bien plus souples — et surtout, plus réalistes — que la démonstration d’une insolvabilité flagrante, souvent impossible à établir sans un accès complet aux documents financiers du débiteur. Par ailleurs, ce revirement jurisprudentiel a aussi une portée préventive, en rappelant à tout débiteur qu’une cession, même habilement déguisée, peut être frappée d’inopposabilité si elle entrave la solvabilité apparente. C’est un garde-fou particulièrement important, en particulier dans les contentieux commerciaux où les montages patrimoniaux sont monnaie courante.